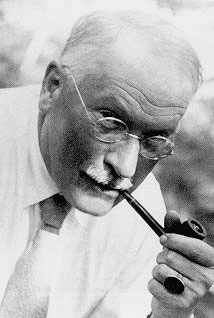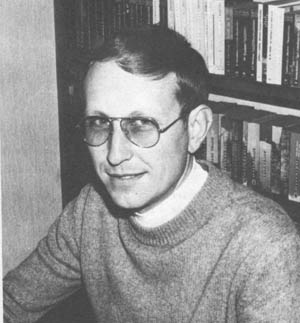Ostentation et caractère élusif
C'est notamment l'ufologue Bertrand Méheust , dans son livre Science-fiction et
soucoupes volantes (Mercure de France, 1978), qui a rendu populaire en France l'idée que les ovnis se
montrent comme dans un spectacle. Un bel exemple de ce caractère ostentatoire est donné par l'analyse qu'a fait
Eric Zurcher de l'arrêt des moteurs lors d'apparitions rapprochées d'ovnis (Les
apparitions d'humanoïdes, Alain Lefeuvre, 1979, pp. 110-113). En effet, les moteurs ne s'arrêtent que si
cet arrêt précède l'observation de l'0VNI. Tout se passe comme si l'arrêt des moteurs n'était qu'un Phénomène
secondaire destiné à éveiller l'attention du témoin pour provoquer la vision de la soucoupe. Il existe un cas où
c'est une bicyclette qui est arrêtée, le cycliste pouvant pédaler, mais sans pouvoir avancer.
, dans son livre Science-fiction et
soucoupes volantes (Mercure de France, 1978), qui a rendu populaire en France l'idée que les ovnis se
montrent comme dans un spectacle. Un bel exemple de ce caractère ostentatoire est donné par l'analyse qu'a fait
Eric Zurcher de l'arrêt des moteurs lors d'apparitions rapprochées d'ovnis (Les
apparitions d'humanoïdes, Alain Lefeuvre, 1979, pp. 110-113). En effet, les moteurs ne s'arrêtent que si
cet arrêt précède l'observation de l'0VNI. Tout se passe comme si l'arrêt des moteurs n'était qu'un Phénomène
secondaire destiné à éveiller l'attention du témoin pour provoquer la vision de la soucoupe. Il existe un cas où
c'est une bicyclette qui est arrêtée, le cycliste pouvant pédaler, mais sans pouvoir avancer.
En parapsychologie, Guy Béney considère comme une
caractéristique du psi son aspect interpellatif, sa tendance à déstabiliser le témoin, c'est-à-dire à remettre en
cause ses croyances.
Le caractère élusif des ovnis, c'est-à-dire la propriété de s'esquiver, de fuir la curiosité, peut être illustré
par les nombreux cas où des témoins ne pensent pas à se servir de l'appareil photographique qui est à leur
portée.
Le caractère élusif peut être plus subtil. Dans le célèbre cas de hantise de Rosenheim, étudié par Hans Bender,
des fils de nylon avaient été tendus au travers des pièces pour retenir dans leurs chutes les tubes de néon qui
quittaient leurs supports. Ces fils, visibles sur les photographies des lieux, ont été considérés par certains
détracteurs comme des preuves flagrantes du caractère truqué des manifestations de Rosenheim.
Ainsi le caractère élusif des Phénomènes paranormaux ne consiste pas seulement à être dans l'impossibilité de
saisir fermement un Phénomène pour l'amener devant un sceptique, mais consiste aussi à ne pas pouvoir éviter que,
même dans les plus beaux cas, se glissent des points litigieux qui pourront plus tard être exploités par les
sceptiques. Une remarquable illustration de ceci peut être trouvée dans la facilité apparente avec laquelle des
ufologues sceptiques démolissent actuellement des témoignages d'apparitions d'ovnis considérés jusqu'ici comme
inébranlables.
Les hypothèses classiques
L'hypothèse extra-terrestre d'une part, et
d'autre part les hypothèses souvent avancées par les parapsychologues, qu'on peut désigner du terme générique
d'"inconscient collectif", et selon lesquelles certains Phénomènes seraient provoqués de façon "psychique" par
l'humanité, présentent des traits communs. Ce sont dans les deux cas des hypothèses assez floues, dépourvues de
point d'attaque, réduisant un Phénomène dont on sait peu de choses à un autre dont on sait encore moins. On peut
dire, par opposition aux hypothèses de travail que l'on prend comme point de départ d'une réflexion, que ce sont
des hypothèses de paresse, à partir desquelles il est difficile d'aller plus loin.
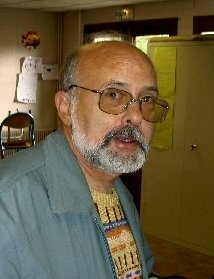 sur les ovnis. Son but est de présenter un
parallèle entre la parapsychologie et l'ufologie. Seront abordées leurs différences,
puis leurs convergences, selon une approche historique, puis au niveau des Phénomènes. Enfin 2 cas précis seront
présentés, qui montreront que la subtilité des arguments apportés par les ufologues et les spirites pour défendre
leurs croyances ne cèdent en rien à celle des arguments apportés par les parapsychologues pour défendre les leurs.
sur les ovnis. Son but est de présenter un
parallèle entre la parapsychologie et l'ufologie. Seront abordées leurs différences,
puis leurs convergences, selon une approche historique, puis au niveau des Phénomènes. Enfin 2 cas précis seront
présentés, qui montreront que la subtilité des arguments apportés par les ufologues et les spirites pour défendre
leurs croyances ne cèdent en rien à celle des arguments apportés par les parapsychologues pour défendre les leurs.